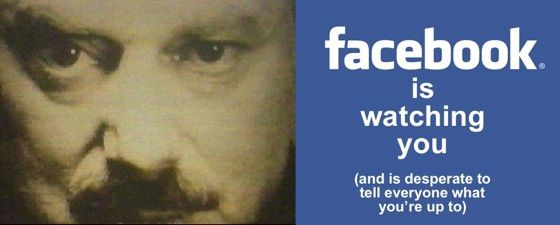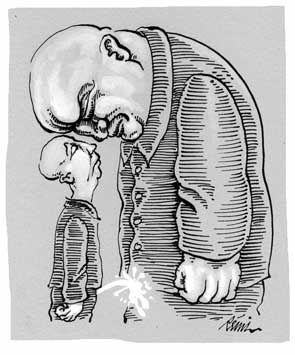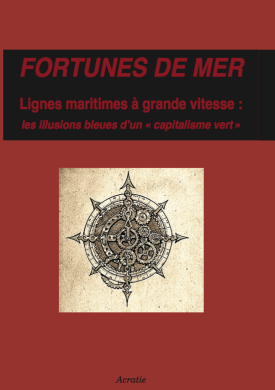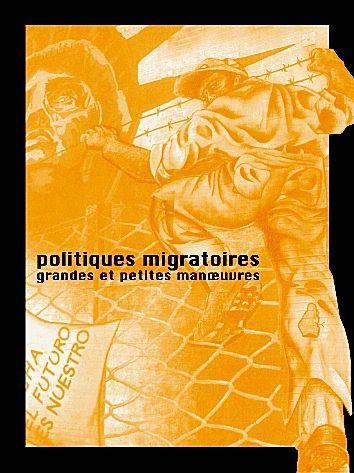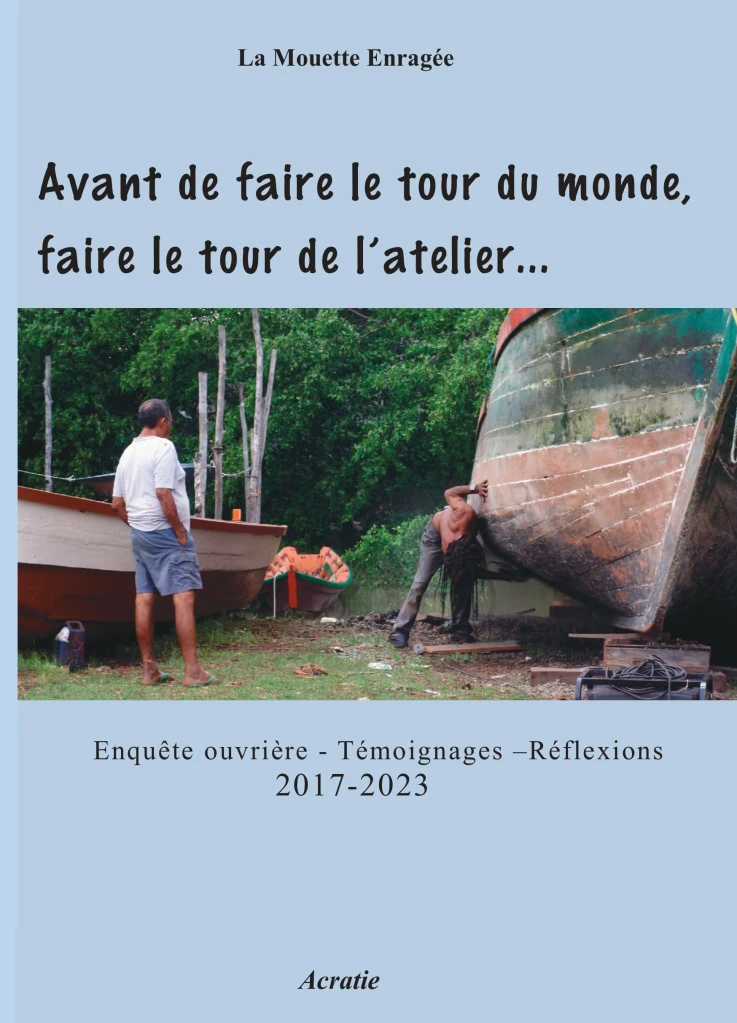Quelques considérations en regard des journées d’octobre/novembre 2010.
En ne débordant pas le périmètre délimité par les centrales syndicales : des journées de grève espacées combinées à des actions le plus souvent symboliques, ce mouvement “contre la réforme des retraites” ne laissait présager qu’une défaite supplémentaire annoncée de longue date.
Pour autant, il serait facile de s’en tenir à ce seul constat et passer sous silence tout ce qui dans le cadre imposé aussi bien qu’à sa marge, le plus souvent au sein des deux à la fois, révéla une volonté, certes minoritaire, mais bien réelle de lutter. C’est en cela, peut être, que cette défaite n’en est pas définitivement une…
Voici quelques éléments éparses qui traduisent cette impression à partir des semaines de protestation telles que nous les avons pu les vivre.

Le contexte général dans lequel se dérouleront les journées d’octobre/novembre 2010 demeure celui qui prévaut maintenant depuis trois décennies. Il se caractérise par la réalisation d’un taux de profit soutenu obtenu par une offensive globale contre le travail. Cette “contre révolution libérale” s’assortit dans sa seconde phase de puissants mouvements financiers, vecteurs de profits immédiats mais facteurs d’une instabilité chronique révélée sous la forme de “crises” répétées et rapprochées. Survenues d’abord en Asie dans les années 90, elles conduiront en 2008 à l’effondrement de la bulle immobilière américaine. Depuis cette date, en Europe, la récession frappe à tour de rôle les économies les plus fragiles du bloc, malmenant l’architecture financière de l’Union toute entière.
Tiraillée en son sein, la bourgeoisie de l’U.E applique néanmoins le train des mesures qui lui permet de tenir la position sur les marchés internationaux. Ainsi, de la Grèce à la France en passant par l’Irlande ou le Portugal, sous des gouvernances de gauche comme de droite, s’impose partout aux travailleurs une seule et même politique. Celle-ci s’inscrit dans le prolongement de la rupture du compromis Fordiste et se fonde essentiellement sur :
- l’ allongement de la durée du travail,
- la réduction des allocations chômage par une politique autoritaire de mise au travail forcé, et maintenant gratuit comme en Angleterre,
- les suppressions massives d’emplois dans le secteur publique; en réalité des plans sociaux couplés aux baisses de salaires,
- la remise en question du contrat de travail,
- la fin du contrat à durée indéterminée au profit d’une employabilité fixée dans le temps par les besoins du patronat.
- la remise en question du salaire par la réduction de la part fixe; extension de l’individualisation de la rémunération liée à la productivité,
- la remise en cause des conventions collectives,
- la baisse du montant des retraites;
- la fin de la retraite par répartition.
L’allongement de la durée du travail – la contre-réforme des retraites – se lit donc unilatéralement. Il fonde à partir d’une grossière propagande d’Etat : la fiction démographique, le vol d’une partie différée du salaire. Il permet à peu de frais aux financiers de faire main basse sur une fraction socialisée du revenu du travailleur; celle qui concourt à la reproduction de sa force de travail. La loi Woerth n’est en cela qu’une épate. L’objectif intermédiaire étant la disparition pure et simple du système dit “de répartition”. A terme, c’est dans la manne des fonds capitalisés que la bourgeoisie se servira comme vient de nous le prouver à titre d’exemple le gouvernement irlandais. Là-bas, l’Etat s’est emparé de 12 milliards d’euros qu’il a saisis dans les réserves des fonds de pensions afin de les distribuer aux banques. Crise oblige.
La réalité syndicale : l’expertise au service de l’offensive patronale.
D’abord, reconnaissons qu’en dehors des syndicats, personne ou presque ne posa dans la forme comme sur le fond la question de la lutte autour des retraites. L’emprise syndicale put donc se déployer sur le seul registre qui vaut pour elle : la destruction d’acquis sociaux en prise avec le rôle gestionnaire qu’exercent encore certaines confédérations au sein de l’appareil d’Etat : caisses de retraites, sécurité sociale, mutuelles etc…
C’est donc à leur propre reproduction et dans l’attente de la loi sur la représentativité de 2013 que les centrales ont travaillé dans l’unité que l’on sait. Une union apparue lors de la lutte contre le CPE et qui repose depuis sur l’ alliance au sommet des deux principales centrales : CFDT et CGT. Le recentrage achevé de cette dernière permet dorénavant ce numéro de duettiste qui trouve son principe dans la faiblesse croissante d’appareils déclinant ( aux alentours de 7,5 % de travailleurs syndiqués en 2005 contre 27 % en 1950). En remettant à plat les conditions de la représentativité, l’Etat espère se garantir auprès d’enseignes éprouvées la pérennité de l’encadrement de la force de travail dans une période incertaine. Il parachève ainsi la restructuration et la concentration du champ syndical et en signe l’intégration aux conditions du jour. Un coup d’oeil rapide sur la l’architecture de la seule CGT ne laisse planer aucun doute sur la question. En quarante ans, et à mesure que le nombre d’adhérents diminuait, celui des permanents y a été multipliée par cinq. Cette bureaucratisation renvoie aux transformations de la composition sociale du salariat et à celle du rapport des forces au sein du groupe. La progression de la catégorie “cadre” bien qu’aujourd’hui en crise et en voie de déclassement dépasse en nombre de syndiqués – notamment au sein des entreprises publiques – celle des ouvriers. Les cadres, base sociale ordinaire de la direction, colonisent les structures syndicales à mesure qu’ils en achèvent la dilution dans le champ du commandement capitaliste. L’arrivée en novembre 2010 d’un cadre à la tête de la fédération CGT des cheminots est à ce titre exemplaire.
C’est dans ces circonstances que l’aire syndicale s’imaginait obtenir de l’Etat l’ouverture de négociations autour du “dossier retraites”. Quelques miettes distribuées à la volées auraient aussitôt suffi à clore le chapitre et permis d’étouffer les voix qui montaient des restes d’une base désorientée et embarrassante. Mais L’Etat refusa et rappela à ses partenaires ce qu’il est dorénavant en mesure d’exiger d’elles : quelles soumettent leur expertise au service des plans qu’il entend imposer aux travailleurs ou alors, qu’elles se taisent*. C’est le prix à payer pour qui fonde aujourd’hui sa légitimité en retour des conseils qu’il prodigue au prince. Les syndicats se confondent maintenant avec les Think-Thank qu’animent leurs “principaux experts” en tête à tête avec le patronat et les bureaucrates. Jean-Christophe le Digou de la CGT est une figure assez emblématique de ce recyclage de la fonction syndicale.
A partir de là, il ne restait à l’intersyndicale qu’à produire un simulacre de mobilisation sur un terrain qui, de fait, confine à l’impuissance : l’opinion publique.
* La collaboration de la CGT aux desseins de patronat repose essentiellement sur deux axes :
d’abord ce qu’elle a baptisé la “Sécurité Sociale Professionnelle” et ensuite le “Nouveau Statut du Travailleur Salarié”.
Deux réponses à l’ordre de flexibilité commandé par l’Etat et le MEDEF.

Une mobilisation en trompe l’oeil.
Fait nouveau, les cheminots répétant que cette fois ils ne porteraient pas le mouvement, la mobilisation s’est organisée de manière plus diffuse et à partir de boîtes privées, le plus souvent en lutte les mois précédents. Le cas des raffineries est à ce titre exemplaire. Autre fait marquant, une géographie de la lutte moins concentrée sur les grosses métropoles. Les actions se sont propagées dans les endroits les moins attendus et ont été recensées sur l’ensemble du territoire.
Dans certaines entreprises, la grève sera reconduite sur quelques jours puis succéderont des arrêts de travail sur les modalités propres à l’organisation du travail posté. A leur tour, d’autres boites saisiront le relais. A aucun moment pourtant, un nombre suffisamment important d’entre elles ne se rejoindront sur un temps commun en dehors des journées d’action. Cette mobilisation fut donc essentiellement celle de délégués adjoints de travailleurs en récupération ou en dehors des postes. La faiblesse des salaires et la précarité expliquent cela, mais sans doute aussi la difficulté à se projeter, à esquisser des contours un peu assuré à la lutte. On pourra également y entendre la manoeuvre d’appareils syndicaux passant en revue des troupes potentiellement mobilisables. Toutefois, on ne saurait ignorer que la crise a réactivé dans certains secteurs des réflexes de lutte qu’une mobilisation, même en trompe l’oeil comme celle des retraites, a pu confirmé. Si cette mobilisation ne fut pas à la hauteur de l’enjeu, essentiellement par le nombre très insuffisant de travailleurs en grève, c’est parce qu’il n’émerge actuellement aucune nouvelle figure de classe capable de catalyser les millions de travailleurs que les syndicats ne représentent pas. Si la classe ouvrière n’a disparue que dans la tête de ceux qui ont intérêt à s’en persuader, il nous faut reconnaître que son fractionnement sape aujourd’hui sa capacité à se présenter en tant que telle face à l’Etat et à la bourgeoisie.
Composition de classe …
La période se caractérise par un marché instable, un fort taux de chômage et une précarité endémique. L’organisation du travail est flottante et globalisée, scellée par un management pervers et criminel qui se diffuse dans l’ensemble des secteurs et anéantit les derniers lambeaux de rigidité ouvrière de la période Fordiste. Transformation du travail, redéfinition ou disparition des catégories, dépossession des savoirs-faire, appauvrissement des taches couplée à une augmentation de la productivité et de la flexibilité, tout concourt à niveler la condition du travailleur et à atomiser les individus, aussi bien sur le lieu de la production que dans la société. Le plus souvent, la conséquence en est la perte du sentiment d’appartenance à la classe elle même. La disqualification des “savoir-faire”, la mise au ban du “métier appris” au profit d’une polyvalence ubiquitaire a dépouillé le travailleur de son identité et hypothéqué le projet collectif qui s’y rattachait – au moins symboliquement. La structure elle même des entreprises : la petite boîte satellisée à l’enseigne internationale, contraint la main d’oeuvre à un Turn-over important; une mobilité forcée qui disloque l’identité collective encrée jusqu’à hier au coeur de l’entreprise.
Enchaîné au dessein d’un réseau de production/circulation éclaté, dématérialisé et mondialisé, le travailleur se dissout dans les entrelacs de la totalité techno-productive. Si hier l’asservissement se vivait sur la chaîne de montage de la planification Fordiste, il s’incarne d’avantage aujourd’hui dans la figure horizontale du réseau et son lacis de flux. De là à conclure qu’une période chassant l’autre, la transition aurait abolit définitivement les termes antérieurs de la domination il n’y a qu’un pas. Le franchir accréditerait l’idée selon laquelle cette horizontalité se substituerait définitivement aux hiérarchies antérieures. L’individualisation des exploités et par conséquent leur neutralisation serait en voie d’achèvement. Les journées d’octobre/novembre ont démontré de manière certes encore ambigu le contraire. Le “post-fordisme” par bien des aspects ne s’éloigne que partiellement de sa matrice. L’installation du “réseau WI-FI” sur les chaînes de montage des usines Ford, par exemple, n’oblitère en rien le face à face entre le travail et le capital. Au contraire, elle en accroît le champ. La chaîne, jusqu’ici rivée à l’usine s’en extrait progressivement par le réseau. Le travailleur occupé ici, demain, usinera là bas. Et c’est ce travailleur nomade, précaire et flexible qui fut le grand absent des journées d’octobre/novembre alors que son objectivation en qualité de sujet collectif demeure un enjeux incontournable de la période.
Mode d’action et forme d’organisation.

Le glissement du champ de la lutte à l’extérieur de l’entreprise, tel que l’on a pu le vivre durant ces deux mois a peut être apporté quelques éléments de réponse. Limités et forcément contradictoires comme le prouve les discussions entamées autour du sens réel des actions de blocage. Il est indéniable que ce mode d’action soit apparu comme un aveu de faiblesse, une incapacité à propager la grève et à l’inscrire dans le temps au sein même de l’entreprise. Mais il fut en partie une réplique aux transformations que les patrons sont parvenus a imposer tant au sein du procès de production, que dans son commandement. Nous aborderons plus loin le problème du vérouillage syndicale. Les blocages ont, dans l’état actuel d’un rapport de force dégradé pour les travailleurs, permit de composer de manière circonstanciée des collectivités à l’extérieur des entreprises où cela ne semblait guère possible. Le territoire, l’échelle locale se sont imposés comme lieux communs en dehors de l’usine de l’école ou des bureaux. En bloquant la marchandise sur les axes de circulation, les zones industrielles ou de distribution, en multipliant les piquets devant les boîtes ou les travailleurs n’étaient pas en grève, on ouvrait de fait un espace en marge des lieux de la production. Un espace qui ne s’est pas formalisé puisque des comités de bases réellement portés par les travailleurs ne sont pas nés de ces journées. Il n’en demeure pas moins que si la grève reste l’outil essentiel pour construire un réel mouvement de classe, la forme que revêt dorénavant le salariat impose de penser ce mouvement aussi bien à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur de ses murs. Les illusoires “blocages” sous bannière syndicale n’ont trompé personne, cependant, ils ont en creux confirmé cette inclination. Les luttes à venir nous apporteront leur éclairage, n’en doutons pas.
La coquille intersyndicale en lieu et place du mouvement.
Si la CGT put s’imposer aussi facilement durant ces deux mois, c’est qu’à contrario de 2003 bien peu de travailleurs étaient en grève. Rappelons qu’il y a sept ans, ce furent des grévistes non syndiqués qui pour une grande partie d’entre eux portèrent le mouvement à bout de bras. Cette fois, la CGT eu beau jeu d’enserrer ses partenaires tout en pianotant la partition du “je t’aime moi non plus” au coude à coude avec un Solidaire empêtré dans ses propres contradictions.
En martelant qu’il ne fallait pas brader le capital de sympathie engrangé auprès de l’opinion, on ne pouvait pas s’attendre à grand chose. Et en effet, il ne se passa rien, ou … presque. Les actions ont put se déployer car pour la plupart elles ne frappaient pas directement les intérêts du patronat. Et lorsqu’à la marge, elles y parvenaient partiellement par un débordement de circonstance, le grand frère syndical admonestait contre “la mise en danger d’activités déjà fragilisées”. Il est d’ailleurs piquant d’entendre un de ses dirigeants nationaux déclarer dans les colonnes des Echos que ce “mouvement” lui aurait “…confirmé qu’on ne peut plus vraiment bloquer le pays”. Quel soulagement ce doit être pour ce brave citoyen …
Pour la direction de la CGT, les actions de terrain ont d’abord servi de soupape à une base syndicale un peu déboussolée par une mobilisation qui n’en n’était pas vraiment une. Elles permirent ainsi d’entretenir le spectacle entre deux dates nationales. La plupart du temps négociées avec la police, elles prenaient fin à l’heure dite. Si bien que la formule repassée de la CGT : “Nous n’avons pas poursuivit mais sachez que cela est remonté en haut lieu…” ne laissait planer aucun doute sur le sens de toutes ces mises en scènes.
Comme nous l’avons évoqué : dans certaines circonstances l’alliance au sommet s’est vu malmenée par l’action commune de regroupements aux limites variables et plurielles. Pour autant, nulle part d’authentiques collectivités de lutte ne se sont substituée à l’intersyndicale des bureaucrates. Pire, c’est en direction de ces appareils, dans le seul espoir, totalement naïf, de détourner le cours de leur stratégie démobilisatrice que certains se sont démenés. Il suffisait pourtant d’écouter Thibaut et sa coterie qui ne cessèrent de rabâcher durant des semaines : “… il n’est pas question de bloquer le pays !” C’est un fait, pour la plupart des travailleurs conscients de la faiblesse de la mobilisation, la priorité n’était pas de sortir du cadre ni d’inventer ou de créer de nouveaux modes et lieu d’organisation mais de faire pression sur celles existantes afin qu’elle fasse ce pourquoi elles seraient censées exister : organiser et combattre. D’où ce sentiment de trahison ressenti depuis des années, de recul en défaite, par ceux qui s’obstinent encore à espérer des bureaucraties syndicales.
La gauche syndicale une vieille histoire…
La gauche syndicale a pu apparaître au delà d’elle même, comme une aire de regroupement un peu plus respirable aux yeux d’un certain nombre de travailleurs, sympathisants, ou simplement conscients de la nécessité de créer une zone échappant à l’emprise des bureaucraties intégrées au jeu de l’Etat. Il est vrai qu’en son sein, la moyenne d’âge y est un peu moins élevée, la présence de femmes y apparaît plus importante et on y affirme une certaine radicalité qui toutefois peine encore à trouver sa traduction en terme de classe. La minorité syndicale organisée dans et autour de Solidaire put ça et là offrir cet ‘en commun” à partir duquel il fut parfois possible de desserrer l’étau, de modifier le sens et la portée de certaines actions. En soi ce n’est pas négligeable. Mais enfin, tout cela est resté relativement anecdotique. Les limites sont d’ailleurs apparues rapidement. Solidaire servit d’abord au couple CGT/CFDT de caution radicale et démocratique. Cette assignation à la fonction d’épouvantail ne pouvait d’ailleurs être remise en question dans le cadre d’une intersyndicale neutralisante. La direction de Solidaire elle même s’est bien gardée de l’envisager. Si l’on revient sur la position partagée localement par l’ensemble des Sud en opposition avec celle de Solidaire national, elle rendait la situation certes intéressante, mais confinait à l’impuissance en l’absence d’une véritable dynamique portée par les travailleurs eux même. Un peu partout sur le territoire, dans les défilés, les cortèges Solidaires sont apparus comme pourvus et offensifs, mais ces manifestants là n’ont pas dans leur grande majorité investi d’avantage le terrain que leur homologues cégétistes ou autres. Faut-il comprendre que même “sudiste” un manifestant demeure pour le moment un manifestant et rien de plus ? C’est un fait, où alors comment expliquer que sur la dizaine de milliers d’adhérents de Solidaire-Nord-pas-de-Calais, une fois encore, seule une minorité ait franchi le pas. Par ailleurs, dans leur grande majorité, là où elles sont structurées, les sections de la gauche syndicale n’échappent pas à l’influence du jeu traditionnel ni à celui des vassalités en cascade. Une réalité qui même lorsque l’on sort du strict champ de sa boîte continue de peser et d’influer sur la manière d’aborder la construction d’un mouvement.
*** CGT : Les vraies raisons d’un faux durcissement. in Les Echos. 17/01/11.
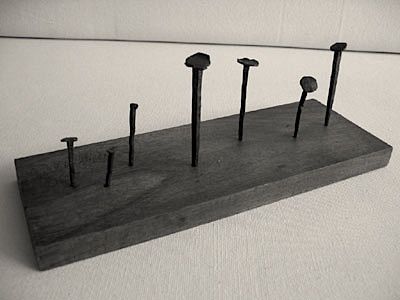
——————————————————–
Encadré : Au fil du syndicalisme rassemblé.
Dans les années 80, la gauche est au pouvoir et les syndicats abdiquent toute volonté de lutte devant les restructurations industrielles et la baisse des salaires. Des travailleurs vont alors s’organiser en dehors du contrôle des centrales. Des comités de grève locaux font leur apparition et se coordonnent au niveau national essentiellement dans la santé, l’enseignement et les chemins de fer*. A l’initiative de syndiqués de la base et de non syndiqués leur apparition traduit la nécessité de se départir de l’emprise des confédérations complices de la politique de l’Etat. Parfois affectées de tendances corporatistes, les coordinations n’en marquèrent pas moins une volonté de reprendre le chemin de la lutte et de gagner au fil de celle-ci en autonomie et en démocratie.
En 1995, ce souvenir est encore vif à la mémoire des bureaucrates, d’autant qu’une gauche syndicale en partie issue des restes des coordinations commence à émerger. Afin de prévenir toute concurrence mais surtout de nouveaux débordements, les directions offrent à la base un cadre plus souple à l’intérieur même du syndicat. Cette parade coïncide dans les années 90 avec le recentrage de la CGT que certains analysent comme une volonté d’ouverture après l’effondrement du bloc de l’Est**. Un assouplissement qui permet surtout de neutraliser en la récupérant la volonté qu’exprime la base d’une unité sur le terrain. Cette stratégie se révélera payante et s’incarnera dans l’intersyndicale au sommet qui naît en 2006, durant la lutte contre le CPE. C’est peut être le dépassement encore balbutiant de ce cadre mortel pour la lutte de classe que l’on a parfois eu le sentiment de toucher du doigt durant les journées d’octobre/novembre.
* Courant alternatif. N° 63. février 1987. Dossier SNCF/ N°64. Mars 1987. SNCF : Bilan d’une grève
** Le références à l’abolition du salariat et à la socialisation des moyens de production ont été supprimés des textes statutaires de la CGT depuis son congrès de 1995.
———————————————–
Encadré : Octobre/novembre à Boulogne-sur-mer.
Boulogne sur mer, premier site européen de transformation des ressources halieutiques est une ville portuaire ou subsiste encore une identité ouvrière. Les actions de blocage ne vont donc pas forcément revêtir ici le caractère de nouveauté qui pour certains distinguerait “ce mouvement”. L’ action directe a toujours été une des armes de la lutte sur le port, au moins lors des mouvements de marins-pêcheurs : blocage de la zone, interception de camions sur l’ autoroute, intervention dans les centre de grande distribution pour enlever ou détruire la marchandise…
Toutes choses qui dans le cadre de cette mobilisation ne furent que simulées…Le cadre intersyndicale ne s’est imposé ici qu’après une habile reprise en main par l’UL CGT. A deux reprises, et en marge de l’intersyndicale, une assemblée ouverte composée de travailleurs des secteurs privés et publics se réunit à la bourse du travail. Au sein de cet espace s’exprima la critique de la stratégie des journées sans lendemain. On y partagea la nécessité mais aussi l’envie d’un véritable rapport de force inscrit sur le terrain économique. La question de la reconduction et de l’élargissement de la grève fut également évoqué lors des échanges. D’emblée, le blocage s’imposa comme la forme d’action à mettre en oeuvre avec un double objectif : porter un coup au patronat local et appeler les travailleurs d’abord occupés à manifester à venir nous rejoindre. Ce ne fut pas totalement un échec. D’abord parce que la tentative de blocage de la zone portuaire où se concentrent les entreprises de transformation de produits de la mer eut lieu. Elle se répétera d’ailleurs avec plus de succès quelques semaines plus tard. Mais il était clair que l’appareil cgtiste jusque là absent du terrain s’empressa de cisailler toute nouvelle tentative en recourant aux bonnes vieilles techniques d’encadrement et de manipulation.
———————————————–
Encadré : Raffineries : le grand coup de bluff syndical.
Durant le mois d’octobre, nous avons ventilé auprès des réseaux militants qui nous sont proches un article paru dans l’hebdomadaire “Le Marin” en date du 29 octobre 2010. Intitulé : “Pétrole : les importations qui ont contournées les raffineries.”, il livrait des informations importantes qui, à notre connaissance, ne seront divulguées nulle part ailleurs dans la presse à cette période.
En effet, si nous n’ignorions pas que : “malgrédouze raffineries à l’arrêt durant une dizaine de jours et les deux principaux terminaux d’importations de brut (Fos-Lavera et la Cim au Havre) toujours bloqués, le carburant continue de couler dans une majorité de pompes à travers le pays. Notamment dans les stations marseillaises, aux portes du plus grand complexe de raffinage français.” et bien sur que : “80 pétroliers sont en rade à Marseille-Fos et 16 au Havre.”qui savait que: “d’autres ont pris le chemin de nombreux dépôts côtiers « De Dunkerque à Bordeaux en passant par Rouen, Port-la-Nouvelle et Sète-Frontignan, les dépôts permettent à la France d’être approvisionnée depuis la zoner RA (Anvers — Rotterdam—Amsterdam), l’Europe du Sud et la Russie » explique Yves Le Goff de l’Union française des industries pétrolières. Mais encore que : “ A Bordeaux, les docks de pétrole d’Ambés, le deuxième dépôt de produits pétroliers raffinés en France (hors raffineries après Fos reçoivent ainsi depuis quelques semaines 100% de produits pétroliers importés …
Nous laisseront les camarades qui publient le bulletin “Dans le monde une classe en lutte”* conclure sur cet épisode en reprenant les commentaires qu’ils ont adjoints à la reproduction in extenso de l’article en question :
1/ :Ce réseau d’approvisionnement empruntait des ports et dépôts pétroliers dont personne n’a parlé au cours du mouvement, surtout pas notamment la CGT qui regroupe l’ensemble des travailleurs des ports et docks, aurait pu faire l’objet d’actions concertées de la part de tous ceux qui dans toute la France exprimaient ,notamment dans la participation aux manifestations leur détermination. Il n’en a rien été : black out d’un côté, ignorance de l’autre ?
2/ Il ne suffit pas de lancer des slogans du style « bloquons l’économie » et d ’amorcer des blocages sporadiques et plus symboliques qu’effectifs si l’on manifeste tant de naïveté et d’inexpérience tant dans la connaissance des structures du système, de ses possibilités de réponses pas seulement répressives mais surtout économiques et du rôle de nuisance que les syndicats peuvent jouer eu égard à tout mouvement tendant à échapper à leur contrôle légal et effectif des relations de travail.
*Reproduction complète de l’article en question sur le site : http://mondialisme.org/spip.php?article1601