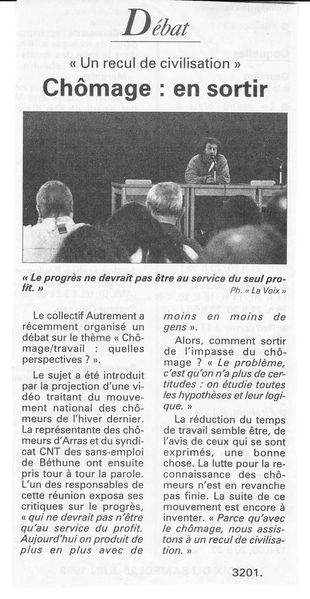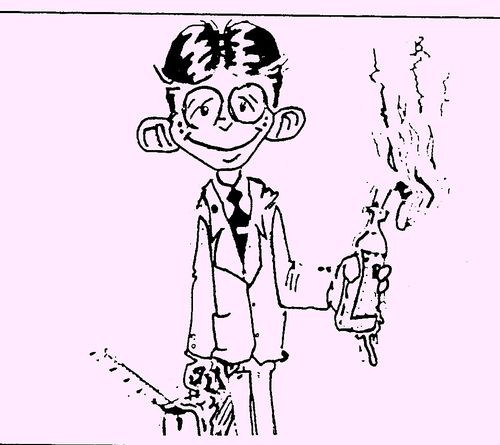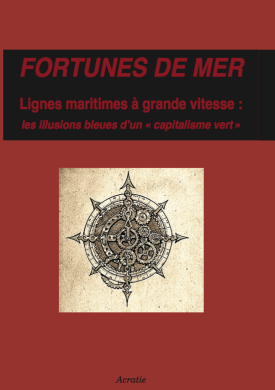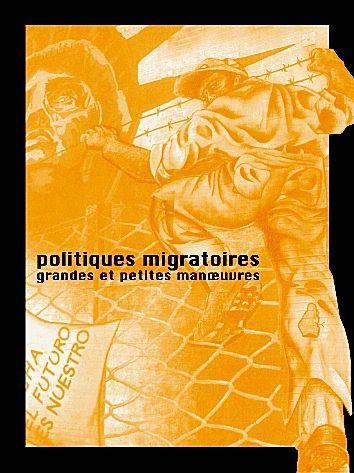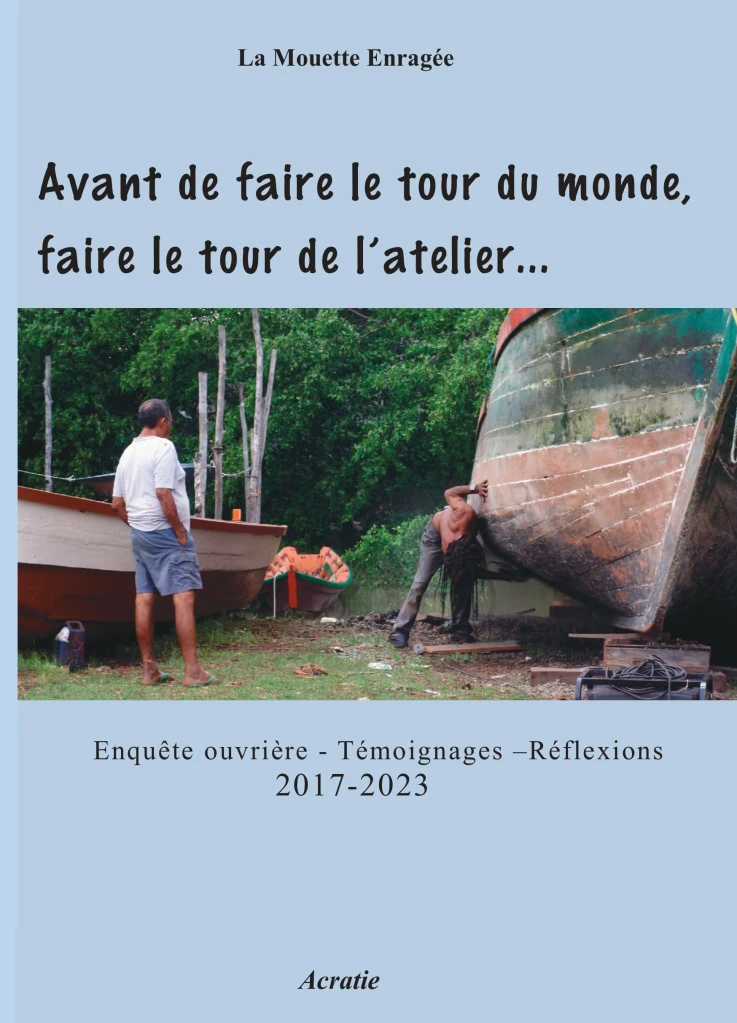Le mouvement des précaires et chômeurs apparu durant l’hiver dernier a marqué une nouvelle étape dans la recomposition du mouvement social. Il nous semblait donc important nous, c’est à dire le collectif « vivre autrement » de faire un bilan public et de confronter nos points de vues sur cette lutte avec les boulonnais. Cela fut fait au début du mois de juin dans la salle du C.C.A.S. Regroupement de circonstance, le collectif n’a depuis donné de suite réelle à ses activités. Le compte rendu qui suit n’est donc pas le fait direct du collectif, mais celui d’un membre de la Mouette ayant participé à ses activités.
Rappelons d’abord la situation telle qu’elle se présentait il y a à peu près un an. Ici, c’est la C.G.T., qui, au travers de son comité de chômeurs est apparue comme le relais légitime de la lutte puisque, nulle autre association spécifique n’existe sur le terrain (1). Le comité de chômeurs CGT fut donc à l’initiative de plusieurs actions en direction de l’A.N.P.E, de l’antenne A.S.S.E.D.I.C. et de la C.A.F. Pour autant, il n’y eu pas de mouvement au sens véritable du terme. Comprenez, de prise en charge de la lutte par les intéressés eux-mêmes au travers d’assemblées générales souveraines, et dans lesquelles les associations et les syndicats ne constituent qu’une des composantes de ce mouvement. Il ne s’agit pas de minorer les actions entreprises par la C.G.T., mais simplement, la définition que nous donnons d’un mouvement est pour nous spécifique (2). Autre constat, et ceci explique cela, la mobilisation des chômeurs et précaires de la ville fut très faible au regard de la situation sociale locale. Cela mériterait que l’on s’y intéresse de plus près mais le temps nous manque, et la désertion de la lutte sociale n’est malheureusement pas circonscrite à ce champ précis…
Pourquoi et comment le collectif « Vivre Autrement »
Il ne s’agissait pas, pour le collectif, de se substituer à un hypothétique mouvement mais de faire passer un point de vue, de nouer des contacts, bref de comprendre la situation politique et sociale du moment. Ce fut donc l’occasion pour des militants de la mouvance anticapitaliste et anti-autoritaire d’échanger leurs idées sur la place qu’occupent aujourd’hui dans notre vie, le travail et son corollaire, le chômage (3). Trois tracts furent rédigés collectivement et distribués aux portes de l’A.N.P.E, dans le centre ville, àla bourse du travail le premier mai, ainsi que sur le plateau du Chemin-vert. Les camarades de la C.N.T. de Dunkerque et Berck, qui participèrent à cette initiative, firent de même dans leur ville respective. Entre temps, quelques militants du collectif participaient à l’occupation d’une A.S.S.E.D.I.C. sur Lille, durant laquelle un de nos camarades se fit interpeller par la police. Il passa en procès au mois de juin et fut relaxé. Décidés à ne pas en rester là, nous avons organisé une rencontre publique afin de dresser le bilan de cette lutte.
Quand arrive l’heure du bilan…
Pour l’occasion, nous avions décidé d’aborder les multiples questions qui se posent en donnant la parole à différents acteurs de la lutte. Devant une quarantaine de personnes un représentant du « Comité Autonome de Chômeurs d’Arras et d’ Ailleurs » livra une description précise de la lutte menée sur la ville. Il évoqua les occupations, qui, si elles furent amplement médiatisées ne reflétaient que l’aspect le plus visible d’un travail de terrain mené de longue date par ce collectif. Plusieurs points essentiels furent débattus tels que 1 ‘extension et la popularisation de la lutte, mais aussi les difficultés que l’on rencontre afin de maintenir la participation et le contrôle de la base face aux tentations hégémoniques. On échangea également sur le rôle des associations et des comités proche de la gauche, ainsi que de la façon dont cette gauche s’y prend pour casser les mouvements sociaux. Les contacts établis par les camarades d’Arras avec le comité des sans papiers de Lille, ainsi que les manifestations de solidarité sur lesquels ils débouchèrent, permirent à certains chômeurs de prendre conscience des galères communes. Pour l’heure, le collectif arrageois continue ses activités (4).
Ce fut ensuite le tour d’un membre du syndicat C.N.T. des sans-emplois de Béthune de retracer l’histoire de sa section. A l’origine adhérente à la C.G.T., elle décida de quitter la centrale de Viannet après s’être fait chasser du local qu’elle occupait. Il semblerait que pour l’heure ce soit la mairie de Béthune qui userait de pressions pour retirer son local aux cénétistes. En deuxième partie d’après midi, Christophe , qui venait de passer en procès quelques jours auparavant, nous apporta son témoignage sur la criminalisation du mouvement social. Depuis le retour des luttes et notamment celle du C.I.P. (5), les pouvoirs en place systématisent la répression. Le scénario est à chaque fois identique, casser le mouvement en criminalisant quelques personnes perçues comme des « meneurs ». Les jugements souvent rendus de façon expéditive, sont en général assortis de peines de prison ferme, ou de lourdes amendes. Ce qui dans un premier temps désamorce tout soutien efficace et vise à court terme à décourager les acteurs du mouvement. A noter qu’un appel pour un « Réseau de solidarité face à la répression » a été lancé dans le courant du mois de juin. Toute personne qui désire en savoir plus, ou simplement prendre connaissance du contenu de cet appel, peut en faire la demande auprès du journal (6).
En fin d’après midi, on ouvrit le débat sur la place du travail salarié dans la société capitaliste et les modalités de sa remise en question. De nombreuses pistes furent discutées, au nombre desquelles, la critique du productivisme, le mythe de la croissance ou encore l’utilité sociale du travail. Une façon de rappeler que cette société ne peut être aménagée comme semble l’entendre la gauche de la gauche.
Parce qu’il faut bien conclure.
Des regrets bien sûr, l’absence remarquée des membres du comité de chômeurs de la C.G.T. qui étaient cordialement invités et à qui nous aurions volontiers laissé la parole. Ce n’est peut-être que partie remise… Mais surtout, les chômeurs, qui nous le savons, ont beaucoup à dire et comme celles et ceux que nous avons rencontré devant l’A.N.P.E. ou ailleurs, n’osent encore faire le pas.
La Voix du Nord s’était déplacée pour l’occasion mais à la lecture de l’article qu’elle a consacré à ce bilan public, nous n’avons pas l’impression d’avoir participer au même débat. Voici l’article en question.
Enfin, la satisfaction d’avoir permis à celles et ceux qui luttent de confronter leurs expériences et ce dans un cadre collectif. Pour toute réaction, information, consultation des tracts rédigés par le collectif, vous pouvez écrire au « Collectif Vivre Autrement », B.P. 403, 62206 Boulogne/Mer Cedex.
Boulogne-sur-mer. Novembre 1998.
Notes
(1) L’ADEFOR (Association Droit pour l’Emploi, à la Formation, à l’Orientation et à la Réinsertion), comme nous l’avons précisé dans le n°17 de la Mouette n’est pas une structure de lutte.
(2) Un mouvement, se définit pour nous plus par les formes de luttes qu’il se donne que par le nombre de ses acteurs et la légitimité que le pouvoir et les médias lui reconnaissent.
(3) La Mouette Enragée/Organisation Communiste Libertaire, la Confédération Nationale du Travail, la Fédération Anarchiste.
(4) Fruit de la lutte, le local, auquel vous pouvez contacter le collectif arrageois porte le nom de « Nouvelle Commune » 82 rue Meaulens 62 000 Arras. Tel 03.21.51.42.16.
(5) Le smic-jeune de Balladur.
(6) A ce titre, nous conseillons de se procurer auprès du « Collectif d’aide aux manifestant/es interpellé/es » au 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris, le guide du manifestant interpellé. Principes et conseils pratiques. Contre un timbre à 3,50 Francs.