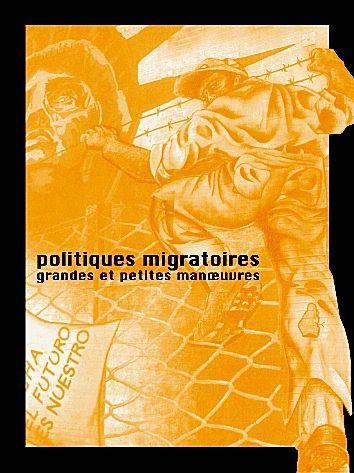Octobre 2011 : Un mouvement passé sous silence
Passé largement inaperçu, le mois d’octobre 2011 a été agité dans les établissements scolaires, alors que le climat social en général était morose. Pendant plus de trois semaines, des blocages et des manifestions ont réuni des lycéens mais aussi des collégiens pour protéger leurs vacances, entre autres. Mais la défense des vacances scolaires n’est qu’un symptôme. Celui d’un malaise de la jeunesse dans l’école, plus particulièrement le malaise d’une partie de la jeunesse déclassée (la plupart du temps dans la voie professionnelle) pour laquelle l’école n’est que le reflet de l’échec.
A Boulogne, c’est au collège Langevin que l’étincelle prend. Un peu avant 8 heures, quelques collégiens (une vingtaine) mettent le feu à des sacs poubelles récupérés dans la rue Aristide Briand ainsi qu’à quelques copies et cahiers devant la grille d’entrée du collège. Mais le mini-incendie est très vite maîtrisé par les pompiers et les quelques incendiaires sont poursuivis par la police. Très vite, la situation revient à la « normale ». La contestation est tuée dans l’œuf, le collège Langevin est le seul réellement touché, rien ne vient des bastions boulonnais traditionnels que sont les lycées. Tout juste circulent sur les téléphones portables quelques messages de blocage mais sans effet concret.
Ailleurs dans la région, ce sont surtout les lycéens qui se mobilisent car on leur reconnaît plus facilement le droit de protester. Le bassin minier est particulièrement mobilisé avec des records de mobilisation à Lens (600 manifestants), Béthune (350 manifestants) et Arras (250 manifestants). Le rectorat estime à vingt le nombre de lycées touchés avec une majorité de lycées professionnels à l’image du lycée professionnel d’Etaples (LP Jules Verne) où il y a 50 manifestants. Les chiffres restent modestes mais témoignent de la spontanéité du mouvement.

Cartographie du mouvement des lycéens et des collégiens faite par la Voix du nord. Outre la belle infographie, nous sommes déjà dans la décrédibilisation et la criminalisation du mouvement. L’accent est mis sur les dégradations (que la presse déplore tout naturellement) et on a franchement l’impression que la région est en guerre.
Justement les lycées professionnels sont les foyers principaux de cette contestation qui ne touche pas seulement l’académie de Lille. Des actions sont aussi menées un peu partout comme en Isère, en Haute-Saône (Vesoul), en Champagne-Ardenne, à Amiens. Les heurts les plus violents ont lieu en région parisienne, au lycée du Chesnay dans les Yvelines, dans une ville de la banlieue chic de Paris où les antagonismes de classe sont importants entre la majorité aisée de la population et la population plus pauvre du lycée professionnel Jean Moulin. Les élèves refusent d’aller en cours tandis que des voitures sont retournées et incendiées.
« Ni leader ni mot d’ordre »
L’expression est empruntée à l’édition locale de la Voix du Nord, mais le mot d’ordre se retrouve dans tous les autres médias qui parlent d’un mouvement totalement « infondé » qui repose sur la rumeur. En effet, le mouvement surprend tout le monde et en premier lieu les syndicats lycéens (essentiellement UNL et la FIDL) qui n’étaient pas au courant des actions menées et qui sur place vont, disent-ils, à la pêche aux informations. A noter que les syndicats lycéens sont surtout implantés dans les lycées généraux or ce sont surtout des lycées professionnels qui se mobilisent.
A la base de la contestation, une information selon laquelle l’éducation nationale supprimerait un mois de vacances scolaires en août. Le rectorat tient alors un double discours. Il nie tout d’abord les informations avancées par les jeunes. Puis il finit par reconnaître qu’un rapport du comité de pilotage sur les rythmes scolaires propose de raccourcir de deux semaines les vacances d’été mais dit-il « le ministère n’a pris pour l’heure aucune décision ». On le voit, le mouvement de colère n’est pas aussi infondé que veulent le faire croire les médias.
En face, il y a des jeunes issus des classes populaires qui veulent garder un acquis symbolique que sont les vacances en réaction à une école dans laquelle ils ne voient aucun avenir et dans laquelle ils s’ennuient fermement. Le refus est d’autant plus ferme qu’ils ne veulent pas passer une minute de plus dans l’encadrement scolaire. Bien sûr à chaud, il n’y a pas forcément de discours construit et intellectualisé car nous sommes dans le domaine du vécu et de la contestation en acte plus qu’en discours. Il est alors facile de faire passer la contestation pour un acte de vandalisme surtout qu’il s’agit d’une catégorie particulièrement visée par la politique sécuritaire de l’état, celle des jeunes des classes populaires. C’est la voie royale pour la répression !
Dans la rue, la police réprime sévèrement les supposés « casseurs », terme quasi générique pour désigner un jeune en révolte. Cet acharnement n’est pas nouveau, il faut se rappeler pour ça des arrestations massives de jeunes qui ont eu lieu notamment dans le centre de Lyon pendant le mouvement des retraites d’octobre 2010, sur la place Bellecour (19 octobre 2010). Rappelons nous aussi de la lutte anti-CPE en 2006 où il y a eu aussi de nombreuses arrestations et des condamnations à la prison ferme. Il reste un compte à régler entre la jeunesse et la police.
Dans ce qui nous concerne, la police a opéré à de nombreuses interpellations suite à des outrages et à des incidents (vols, projectiles). Dans la région, notons une quinzaine d’interpellations à Arras où comme le dit la Voix du Nord « des jeunes, porteurs de capuche sur la tête ou d’écharpe sur une partie du visage, ont été interpellés. Même traitement pour les plus énervés du lot ». Même chose à Lens avec 6 interpellations mais aussi des gardes à vue. Les jeunes n’ont qu’à bien se tenir et bien s’habiller car gare aux capuches et autres écharpes depuis la loi anticagoule (votée en 2009).
Répression et intimidation sont aussi les lots de l’institution scolaire. A Boulogne, une plainte a été déposée à la brigade des mineurs. Ces dépôts de plainte sont fréquents dans un collège ou un lycée mais, par cette procédure, on évacue toute lecture collective et sociale d’une action. C’est tellement plus facile de voir dans un mouvement de jeunes de la simple délinquance plutôt que d’y voir une tentative d’organisation collective même si celle ci est, de fait, maladroite et violente. S’agissant de l’intimidation, l’institution scolaire a su mettre à profit le développement des outils de communication.
Les suites : l’encadrement du mouvement et la perte de dynamique
Lundi 3 octobre : le Sud Ouest est un foyer de contestation. Blocage des lycées à Pau (lycée professionnel Baradat et le lycée Saint-John-Perse)
Jeudi 6 octobre : les lycées généraux se mobilisent, notamment à Paris. 300 lycéens font une manifestation Bastille-Nation mais déjà le mouvement perd de sa spontanéité. Les syndicats lycéens (surtout UNL et FIDL) sont aux commandes et rattachent leurs revendications aux revendications des professeurs (suppressions de postes, sur effectif des classes). Il n’est plus question de la filière professionnelle qui ne compte quasiment pas de syndiqués1
Mardi 11 octobre : Journée nationale de manifestation contre la politique d’austérité. Les jeunes y participent. Selon les syndicats, « dans toute la France, au total, 9500 lycéens ont défilé et 125 lycées ont été bloqués ou étaient le théâtre d’assemblées générales ». Sur le terrain, blocages et manifestations se font surtout dans les grandes villes comme à Paris, Toulouse, La Rochelle, Lille. Toutes les organisations rejoignent l’intersyndicale. La lutte de terrain est définitivement abandonnée, en réalité elle ne s’est jamais vraiment structurée.
Avec l’approche des vacances, faiblissement général. Les lycées professionnels à la base du mouvement ne sont plus mobilisés car sévèrement réprimés dès le début. A la suite du 11 octobre, quelques actions sont menées mais sans réelle perspective comme le blocage improvisé du lycée Baggio (à majorité technique et professionnelle) le jeudi 20 octobre, qui rassemble tout de même 150 lycéens. La police disperse les jeunes.
La révolte 2.0 : Police = 2 / Jeunes : 0
Au cours de cette contestation du mois d’octobre, les nouvelles technologies ont eu une grande importance dans la mobilisation et l’organisation des actions. Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, MSN) ont permis de faire circuler largement et rapidement les mots d’ordre.
Néanmoins la rapidité et la spontanéité de ces nouveaux moyens de communication ont desservi la mobilisation des jeunes et l’efficacité de leur action :
Tout d’abord, cette rapidité de circulation de l’information a renforcé l’idée qu’il s’agissait d’une rumeur infondée, ce qui a fait les choux gras de la presse et des pouvoirs publics. Sur les SMS et les mails, ne circulaient que les mots d’ordre de blocage avec la revendication principale mais rien sur les possibles discussions (cette fois-ci bien réelles), les autres malaises rencontrés en classe et les modalités d’organisation.
Cette forme de communication s’avère être une formidable arme de renseignement. Sur les réseaux sociaux, il existe des faux comptes d’utilisateurs, des taupes mis en place par l’administration pour repérer les mots d’ordre divers qui peuvent circuler entre les élèves. L’administration était au courant des mobilisations, par exemple à Boulogne où policiers et pompiers étaient déjà sur place avant même le début du mini-blocage, vendredi 30 septembre. Au final, être derrière un ordinateur est beaucoup moins anonyme et discret que de discuter dans la rue.
Rappelons que la surenchère de communication marche aussi dans l’autre sens, c’est à dire à destination des parents d’élèves qui reçoivent les démentis d’actions que les jeunes veulent organiser et l’injonction par la direction d’emmener leur enfant en classe. Cette nouvelle communication des établissements scolaires a été testée à grande échelle lors du mois d’octobre 2010, pendant le mouvement des retraites et depuis elle est incessante. Désormais, pour la moindre absence, un SMS est envoyé sur le portable des parents, plus rien n’échappe à la surveillance.
Les filières professionnelles en avant poste
Même si la mobilisation des collégiens et des lycéens n’a abouti à rien, elle est révélatrice d’un climat latent qui règne entre la jeunesse et l’état (et donc l’école) mais pas n’importe quelle jeunesse, la jeunesse déclassée économiquement (via leur origine sociale) et intellectuellement car il s’agit d’une jeunesse en échec scolaire.
Ce n’est pas pour rien que la mobilisation a commencé dans les lycées professionnels et à Boulogne dans l’établissement scolaire le plus ghettoïsé de l’agglomération (le collège Langevin). Les jeunes concernés ont cette conscience et surtout ce vécu d’appartenir à un groupe défavorisé et délaissé par l’école et la société toute entière. Malgré les discours encore prégnants sur une école qui donnerait sa chance à tout le monde grâce au collège unique et à la méritocratie individuelle, l’école n’a jamais été émancipatrice pour les classes populaires. Pire, l’école dans son mouvement historique (depuis Jules Ferry) de démocratisation s’avère être le lieu du tri social et de la ségrégation. Des études récentes2 montrent qu’un enfant d’origine populaire a 7,6 fois plus de « chances » de demander une orientation professionnelle que les autres milieux (classes moyenne et privilégiée).
Deux grands processus sont à l’œuvre. Tout d’abord, un processus interne au milieu social d’origine qui fait ses choix et raisonne en fonction de son environnement immédiat. Bien souvent celui des quartiers prolétarisés où l’école n’a jamais été un atout pour trouver un travail : ce sont d’autres réseaux à l’œuvre. D’autre part, il y a un processus interne à l’école qui dès le collège met en place des relégations comme les sections spécialisées type SEGPA ou les redoublements qui découragent plus qu’ils ne motivent les jeunes en échec scolaire. En effet, on observe de moins en moins de mixité sociale dans ces filières, ce qui renforce le sentiment d’appartenance à une culture anti-école avec ses propres règles : dénoncer les fayots, résister au savoir non-technique, etc. Au final, la plupart de ces jeunes sont relégués dans les filières professionnelles qui tendent à se prolétariser.
La filière générale : des attentes différentes
Avec l’arrivée des lycées généraux dans la contestation, les modalités d’actions ont été totalement bouleversées : place à la négociation et au lissage des actions, on rentre finalement dans un cadre contestataire traditionnel (blocage, manifestation, négociation via les syndicats pour finalement finir dans une intersyndicale illusoire). Dans les discours, les élèves de la filière générale réclamaient plus de moyens, « on ne veut plus de classe à 35 élèves ». Pas sûr que les élèves de la filière professionnelle aient les mêmes attentes. Eux voulaient avant tout protéger un acquis, celui des vacances comme le font leurs parents travailleurs quand ils font grève pour les retraites.
En classe, une lutte des classes
Malgré le discours ambiant de démocratisation de l’école et de méritocratie (seulement valable pour les classes moyennes et supérieures), l’institution scolaire entretient des antagonismes de classe car celle-ci est avant tout bourgeoise de par le savoir et les références qu’elle veut diffuser. Dans son sein, une partie de la jeunesse entre en résistance frontale avec l’institution. Cela donne des colères épisodiques comme lors du mouvement d’octobre 2011. En classe, cela se manifeste par une résistance au professeur et au savoir qu’il veut inculquer. De fait, une culture anti-école s’entretient dans ces milieux sociaux.
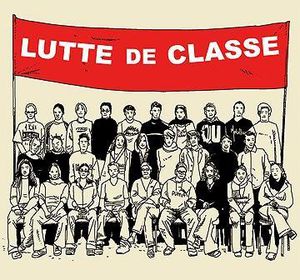
Mais l’école tend à sortir vainqueur de cette lutte interne car le tri social est finalement effectué à force de résignation de la part des élèves en « échec » par rapport à l’institution scolaire. C’est ce que montre le sociologue anglais Paul Willis3 : une contradiction fondamentale persiste. Les enfants des « classes défavorisées » en échec et rétifs dans et à l’institution scolaire finissent par faire advenir un futur que d’autres avaient conçu pour eux. Ils s’accommodent au non choix qu’on leur donne, en fait c’est leur culture de s’accommoder de la situation (à l’école ou en entreprise). D’eux mêmes, ces élèves finissent par manquer d’ambition scolaire et expriment un « refus du risque de l’espoir ».
——————————————————————–